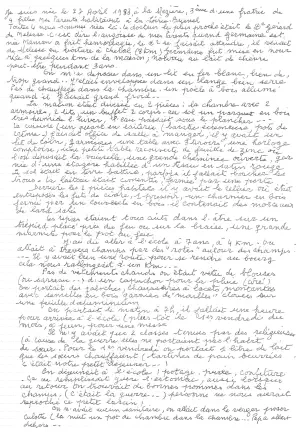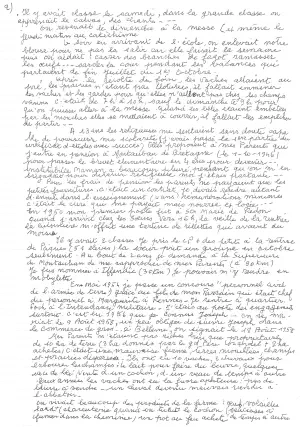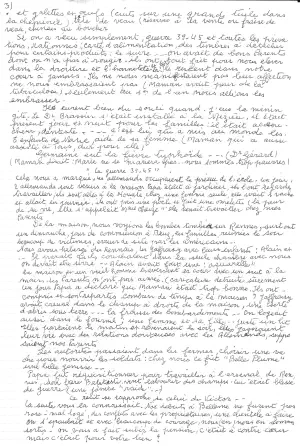Les mémoires de Simone MONNIER#
Naissance#
Je suis née le 27 Avril 1933 à la Mézière, 3
On m’a déposée dans un lit en fer blanc, bien de trop grand. J’étais enveloppée dans un lange bien serré pas de chauffage dans la chambre. Un poêle à bois était allumé quand il gelait grand froid.
La maison#
La maison était divisée en 2 pièces : la chambre avec 2 armoires, 2 lits, un buffet 2 corps. Au sol un parquet en bois très humide l’hiver, l’eau passait sous le plancher…
La cuisine (un quart en laiterie : baratte écrémeuse, pots de crème) faisait office de salle à manger. Il y avait un lit de coin, 3 armoires, une table avec 3 tiroirs, une horloge comtoise, une petite table recouverte de feuilles de zinc où l’on déposait la vaisselle, une grande cheminée ouverte, garnie d’une étagère habillée d’un tissu en satin rouge.
Le sol était en terre battue, parfois il fallait boucher les trous. La laiterie était cimentée, fermée par une porte.
Derrière les 2 pièces habitées il y avait le cellier où était entreposés les fûts de cidre, un pressoir, un charnier en bois fermé par un couvercle en bois. Il contenait des morceaux de lard salés. Les repas étaient tous cuits dans l’âtre sur un trépied placé près du feu ou sur la braise, une grande marmite pour le pot au feu.
La jeunesse et l’école (vers 1940)#
J’ai du aller à l’école à 7 ans, à 4 km. On allait travers champs par des “rotes” autour des champs. Il y avait bien une route pour se rendre au bourg, cela nous rallongeait d’un kilomètre.
Pas de vêtements chauds on était vêtue de blouses (ou sarreau), d’un capuchon pour la pluie (ciré). On portait des galoches, chaussures à lacets montantes avec semelles en bois garnies de clous sur une feuille d’aluminium.
On partait le matin à 7h, il fallait une heure pour arriver à l’école (plus tôt le 1er vendredi du mois, à jeun, pour une messe).
Il n’y avait que 2 classes tenues par des religieuses (à cause de la guerre elles ne portaient pas l’habit de sœur). Pour le 1er vendredi on portait 1 litre de lait que les sœurs chauffaient (tartines de pain beurrées). C’était notre petit déjeuner.
On déjeunait à l’école : potage, purée, confiture. Ça ne remplissait guère l’estomac, aussi lorsque au retour on trouvait de bonnes pommes dans les champs (c’était la guerre…), personne ne nous aurait reproché ce petit larcin.
On n’avait aucun sanitaire, on allait dans le verger près du potager (la nuit un pot de chambre dans la chambre). Papa allait dehors.
Il y avait classe le samedi. Dans la grande classe, on apprenait le calcul, des chants.
On revenait le dimanche à la messe (et même le vendredi matin au catéchisme).
Le soir en arrivant de l’école, on enlevait notre blouse pour ne pas la salir, car elle faisait la semaine puis on aidait : casser des branches de fagot, ramasser les œufs, sarcler la cour pendant les vacances qui partaient de fin juillet au 1er octobre.
Après la récolte du foin, les vaches allaient au pré. Les prairies n’étant pas clôturées, il fallait emmener les vaches et les garder pour qu’elles n’aillent pas chez les champs voisins. C’était de 7h à 10h sauf le dimanche à 9h pour qu’on puisse aller à la messe. Quand les bêtes étaient embêtées par les mouches, elles se mettaient à courir, il fallait les empêcher de partir.
Poursuite des études (vers 1946)#
À 13 ans, les religieuses me sentaient sans doute capable de poursuivre ma scolarité (j’avais passé la 1ère partie du certificat d’études avec succès).
Elles proposèrent à mes parents que j’entre en pension à Montauban de Bretagne (le 1-10-1946) pour passer le brevet élémentaire en 4 ans pour devenir institutrice. Maman a beaucoup pleuré, pensant qu’on m’enbrigadait pour devenir religieuse, moi j’étais partante.
Pour les frais de pension, les parents ne payaient que les petites fournitures. C’était un contrat, je devais rendre autant d’années dans l’enseignement (4 ans). Rémunérations minimes, c’était le curé qui me payait mais nourrie et logée.
Institutrice#
En 1950, mon premier poste fut à Sainte Marie de Redon. Quand j’arrivai chez les Sœurs vers 16h, la veille de la rentrée, la cuisinière m’offrit une tarteine de rillettes qui avaient du moisi.
Il y avait 2 classes. Je pris le CP + des petits à la rentrée de Pâques (51 élèves). La sœur prit un groupe en octobre seulement.
Au bout de 2 ans, je demande à la Supérieure de Montauban de me rapprocher de mes parents (à 90 km). Je fus nommée à Iffendic (30 km) je pouvais m’y rendre en mobylette.
En mai 1954, je passe un concours “personnel civil de l’armée de terre” grâce au fils de mon parrain qui était chef du personnel à Marquerite à Rennes. Je rentre à Quartier Foch à l’Intendance militaire. J’étais au poste des engagements.
Mariage#
C’est en 1956 que je connus Joseph. On se maria le 9 août 1958, un peu obligée de suivre Joseph dans le commerce de gros à Belleme, on signait le 18 août 1958.
Vie des parents#
Mes parents n’étaient pas riches bien que propriétaires de 10 ha de terre (8 ha donnés par le grand-père Lorandel et 2 ha achetés). C’était une mauvaise ferme, terres mouillées, champs et prairies dispersés. Ils ont eu 10 vaches, 2 chevaux pour labourer les champs, le lait pour faire du beurre, quelques sacs de blé, vente d’un cochon, d’un veau de temps à autre.
Deux années les vaches ont eu la fièvre aphteuse : pas de beurre à vendre, un cheval devenu mauvais vendu à l’abattoir.
On vivait beaucoup des produits de la ferme : œufs, volailles, lard, charcuterie quand on tuait le cochon (saucisses à cuire dans la cheminée), un pot au feu acheté de temps à autre, et galettes et œufs (cuits sur une grande tuile dans la cheminée), tête de veau (réservée à la vente) ou fraise de veau), chinées au boucher.
Si on a vécu simplement, guerre 39-45 et toutes les privations, rationnements, carte d’alimentation, des tickets à détacher pour certains produits : e sucre.
On avait de bons parents, dont on n’a pas à rougir. Ils ont tout fait pour nous élever dans la droiture et l’honnêteté et la foi. Ils restent dans notre cœur à jamais. Ils ne nous manifestaient pas leur affection, ne nous embrassaient pas (maman avait peur de la tuberculose). Seulement au 1er de l’an, nous allions les embrasser.
Ils eurent bien du souci quand j’eus la méningite… Le Dr Brassier s’était installé à la Mézière, il était présent jour et nuit pour les familles. Il était accueillant, dévoué. C’est lui qui a mis au monde les 6 enfants de Marie, aidé de sa femme (maman qui a aussi assisté à tous, dur pour elle). Germaine eut la fièvre typhoïde (Dr Gérard). Maman disait : “Marie ne se mariera pas, nous sommes trop pauvres.”
La guerre 39-45#
Cela nous a marqués. Les Allemands occupaient le préau de l’école. Un jour, 2 Allemands sont venus à la maison. Papa était à jardiner, ils l’ont regardé trvailler. Ils sont allés à la Nouate chez une femme seule, elle avait 4 vaches et allait en journée. Ils ont pris une poële et fait une omelette (la peur de sa vie). Elle s’appelait Mme Cheize. Elle avait travailler chez mes parents.
De la maison, nous voyions les bombes tomber sur Rennes. Surtout un dimanche, jour de communion à Bruz, les familles réunies. Le soir, beaucoup de victimes, erreur de site par les Américains…
Nous avons hébergé des Rennais, les Jaffraisy avec leurs enfants. Alain et… Ils couchèrent dans la seule chambre avec nous. On devait être serrés. Alain avait fait une aquarelle, la maison et un vieil homme traversant la cour avec un seau à la main. Les parents n’ont pas aimé. Caricature détruite sûrement un jour.
Papa a déclaré que maman était trop bonne. Ils ont compris et sont repartis. Combien de temps à la maison ? Jaffraisy avait creusé dans le champ à droite de la maison, une sorte d’abri sous terre. La frousse des bombardements.
On logeait aussi dans le fournil, une femme et sa fille. Juste un lit. Elles partaient le matin et revenaient le soir. Elles gagnaient leur vie avec des relations douteuses avec les Allemands, supposaient nos parents.
Les autorités passaient dans les fermes, choisir une vache pour nourrir les soldats. Chez nous, ce fut “Belle Plume”, une belle génisse.
Papa fut réquisitionné pour travailler à l’arsenal de Rennes. Son frère Baptiste vint labourer des champs. Il était blessé de guerre (une jambe “raide”). Ce récit se rapprocher de celui de Victor.
La suite, vous la connaissez. Nos débuts à Belleme ne furent pas roses : mal logé, des conflits avec les propriétaires, une clientèle à faire, on s’épaulait et avec beaucoup de courage, nous nous en sommes sortis. On vous a fait subir la pension. C’est à contrecœur, mais c’est pour votre bien.